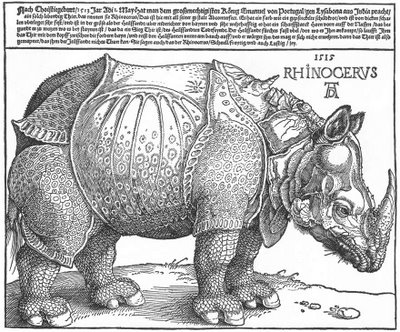The Aberdeen Bestiary Project
La presomption est nostre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les creatures c’est l’homme, et quant et quant, la plus orgueilleuse. Elle se sent et se void logée icy parmy la bourbe et le fient du monde, attachée et cloüée à la pire, plus morte et croupie partie de l’univers, au dernier estage du logis, et le plus esloigné de la voute celeste, avec les animaux de la pire condition des trois : et se va plantant par imagination au dessus du cercle de la Lune, et ramenant le ciel soubs ses pieds. C’est par la vanité de ceste mesme imagination qu’il s’egale à Dieu, qu’il s’attribue les conditions divines, qu’il se trie soy-mesme et separe de la presse des autres creatures, taille les parts aux animaux ses confreres et compagnons, et leur distribue telle portion de facultez et de forces, que bon luy semble. Comment cognoist il par l’effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux ? par quelle comparaison d’eux à nous conclud il la bestise qu’il leur attribue ?
Quand je me jouë à ma chatte, qui sçait, si elle passe son temps de moy plus que je ne fay d’elle ? Nous nous entretenons de singeries reciproques. Si j’ay mon heure de commencer ou de refuser, aussi à elle la sienne. Platon en sa peinture de l’aage doré sous Saturne, compte entre les principaux advantages de l’homme de lors, la communication qu’il avoit avec les bestes, desquelles s’enquerant et s’instruisant, il sçavoit les vrayes qualitez, et differences de chacune d’icelles : par où il acqueroit une tres parfaicte intelligence et prudence ; et en conduisoit de bien loing plus heureusement sa vie, que nous ne sçaurions faire. Nous faut il meilleure preuve à juger l’impudence humaine sur le faict des bestes ? Ce grand autheur a opiné qu’en la plus part de la forme corporelle, que nature leur a donné, elle a regardé seulement l’usage des prognostications, qu’on en tiroit en son temps.
Ce defaut qui empesche la communication d’entre elles et nous, pourquoy n’est il aussi bien à nous qu’à elles ? C’est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point : car nous ne les entendons non plus qu’elles nous. Par ceste mesme raison elles nous peuvent estimer bestes, comme nous les estimons. Ce n’est pas grand merveille, si nous ne les entendons pas, aussi ne faisons nous les Basques et les Troglodytes. Toutesfois aucuns se sont vantez de les entendre, comme Apollonius Thyaneus, Melampus, Tiresias, Thales et autres. Et puis qu’il est ainsi, comme disent les Cosmographes, qu’il y a des nations qui reçoyvent un chien pour leur Roy, il faut bien qu’ils donnent certaine interpretation à sa voix et mouvements. Il nous faut remerquer la parité qui est entre nous : Nous avons quelque moyenne intelligence de leurs sens, aussi ont les bestes des nostres, environ à mesme mesure. Elles nous flattent, nous menassent, et nous requierent : et nous elles.
Au demeurant nous decouvrons bien evidemment, qu’entre elles il y a une pleine et entiere communication, et qu’elles s’entr’entendent, non seulement celles de mesme espece, mais aussi d’especes diverses :
Et mutæ pecudes, Et denique secla ferarum
Dissimiles suerunt voces variásque cluere
Cum metus aut dolor est, aut cum jam gaudia gliscunt.
(Les troupeaux sans parole et les bêtes sauvages par des cris différents et variés expriment la crainte, la douleur ou le plaisir qu’ils sentent. Lucrèce, V, 1058.)
En certain abboyer du chien le cheval cognoist qu’il y a de la colere : de certaine autre sienne voix, il ne s’effraye point. Aux bestes mesmes qui n’ont pas de voix, par la societé d’offices, que nous voyons entre elles, nous argumentons aisément quelque autre moyen de communication : leurs mouvemens discourent et traictent.
Non alia longè ratione atque ipsa videtur
Protrahere ad gestum pueros infantia linguæ.
(Ce n'est pas autrement que l’on voit les enfants suppléer par le geste à leur voix impuissante. Lucrèce, V, 1029.)
pourquoy non, tout aussi bien que nos muets disputent, argumentent, et content des histoires par signes ? J’en ay veu de si souples et formez à cela, qu’à la verité, il ne leur manquoit rien à la perfection de se sçavoir faire entendre. Les amoureux se courroussent, se reconcilient, se prient, se remercient, s’assignent, et disent en fin toutes choses des yeux.
E’l silentio ancor suole
Haver prieghi e parole.
(Et le silence encore peut avoir prières et paroles. Le Tasse, Aminte, II, chœur 34.)
Quoy des mains ? nous requerons, nous promettons, appellons, congedions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, craignons, vergoignons, doubtons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, tesmoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, mesprisons, deffions, despittons, flattons, applaudissons, benissons, humilions, moquons, reconcilions, recommandons, exaltons, festoyons, resjouïssons, complaignons, attristons, desconfortons, desesperons, estonnons, escrions, taisons : et quoy non ? d’une variation et multiplication à l’envy de la langue. De la teste nous convions, renvoyons, advoüons, desadvoüons, desmentons, bienveignons, honorons, venerons, dedaignons, demandons, esconduisons, egayons, lamentons, caressons, tansons, soubsmettons, bravons, enhortons, menaçons, asseurons, enquerons. Quoy des sourcils ? Quoy des espaules ? Il n’est mouvement, qui ne parle, et un langage intelligible sans discipline, et un langage publique : Qui fait, voyant la varieté et usage distingué des autres, que cestuy-cy doibt plustost estre jugé le propre de l’humaine nature. Je laisse à part ce que particulierement la necessité en apprend soudain à ceux qui en ont besoing : et les alphabets des doigts, et grammaires en gestes : et les sciences qui ne s’exercent et ne s’expriment que par iceux : Et les nations que Pline dit n’avoir point d’autre langue.
Michel de Montaigne, Essais, livre II, chapitre 12, Apologie de Raymond Sebond.